 « Le » terrorisme a beau être présenté comme globalement unifié dans le discours politique et médiatique dominant, son incarnation « la plus dangereuse » contre laquelle il faut former « un nouveau front » a tendance à être sacrément changeante selon les moments. Le 7 octobre 2001, le porte-parole de la Maison-Blanche, Ari Fleicher annonçait fièrement le déclenchement des bombardements en Afghanistan en lançant un bravache « Nous avons ouvert un nouveau front dans notre guerre contre le terrorisme ». Un an plus tard, c’était l’Irak qui devenait le front principal de la guerre au terrorisme en raison de liens imaginaires entre Al Qaïda et le régime de Saddam Hussein qui – comme Colin Powell vint l’assurer aux membres du Conseil de sécurité de l’ONU – développait des armes de destruction massive et comptait - charmante attention - les offrir à Ben Laden. Les « nouveaux fronts » continuèrent de se multiplier à grande vitesse. A l’été 2006, George W. Bush déclara à la presse : « l’offensive lancée par Israël contre le Liban a ouvert un troisième front de la guerre antiterroriste ». L’Iran hérita de ce titre officieux aux environs de 2006, le Daily Telegraph et le Figaro allant jusqu’à assurer - sur la foi de sources anonymes mais liées aux services secrets occidentaux selon les articles - que l’Iran chiite était en train de développer son influence au sein de l’organisation du wahhabite Ben Laden, affirmation aussi crédible que d’imaginer une influence croissante du Dalaï Lama dans la Curie romaine. Pendant sa campagne présidentielle, Barack Obama assurait que le front principal de la guerre au terrorisme devait être les zones tribales pakistanaises et l’Afghanistan. Peu de temps après, début 2010, c’est le Yémen qui est devenu, comme le déclara RFI, « le troisième front de la guerre contre le terrorisme » (le décompte de RFI avait oublié quelques « fronts » au passage, on avait largement dépassé le troisième)… etc.
« Le » terrorisme a beau être présenté comme globalement unifié dans le discours politique et médiatique dominant, son incarnation « la plus dangereuse » contre laquelle il faut former « un nouveau front » a tendance à être sacrément changeante selon les moments. Le 7 octobre 2001, le porte-parole de la Maison-Blanche, Ari Fleicher annonçait fièrement le déclenchement des bombardements en Afghanistan en lançant un bravache « Nous avons ouvert un nouveau front dans notre guerre contre le terrorisme ». Un an plus tard, c’était l’Irak qui devenait le front principal de la guerre au terrorisme en raison de liens imaginaires entre Al Qaïda et le régime de Saddam Hussein qui – comme Colin Powell vint l’assurer aux membres du Conseil de sécurité de l’ONU – développait des armes de destruction massive et comptait - charmante attention - les offrir à Ben Laden. Les « nouveaux fronts » continuèrent de se multiplier à grande vitesse. A l’été 2006, George W. Bush déclara à la presse : « l’offensive lancée par Israël contre le Liban a ouvert un troisième front de la guerre antiterroriste ». L’Iran hérita de ce titre officieux aux environs de 2006, le Daily Telegraph et le Figaro allant jusqu’à assurer - sur la foi de sources anonymes mais liées aux services secrets occidentaux selon les articles - que l’Iran chiite était en train de développer son influence au sein de l’organisation du wahhabite Ben Laden, affirmation aussi crédible que d’imaginer une influence croissante du Dalaï Lama dans la Curie romaine. Pendant sa campagne présidentielle, Barack Obama assurait que le front principal de la guerre au terrorisme devait être les zones tribales pakistanaises et l’Afghanistan. Peu de temps après, début 2010, c’est le Yémen qui est devenu, comme le déclara RFI, « le troisième front de la guerre contre le terrorisme » (le décompte de RFI avait oublié quelques « fronts » au passage, on avait largement dépassé le troisième)… etc.Comme le plus hideux visage de l’hydre terroriste a tendance à se situer souvent à l’endroit et au moment précis où les États-Unis ont des intérêts stratégiques forts, certains – les malveillants paranoïaques que voilà ! – ont émis l’hypothèse qu’invoquer la poursuite de « la guerre au terrorisme » pourrait être un prétexte commode pour déployer ou accentuer une présence militaire états-unienne et/ou de leurs alliés dans certaines régions du monde. Franchement, où les gens vont-ils chercher des idées pareilles ?
La semaine dernière, le général Carter F. Ham, commandant en chef de l’US Africa Command (US Africacom), le commandement unifié de toutes les opérations militaires et sécuritaires des États-Unis en Afrique a ouvert un nouveau « nouveau front » de la guerre contre le terrorisme - et un grand ! - puisqu’il concerne l’Afrique, du Nigeria à la Somalie en passant par toute la région du Sahel. Le 14 septembre, dans un discours largement repris par la presse états-unienne ou la presse africaine francophone mais peu commentée dans la presse française, Carter Ham pointait trois nouvelles menaces : Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), les Shebab somaliens et la secte Boko Haram au Nigeria. Le général, qui assurait également le commandement des opérations de l’OTAN en Libye, affirma, en outre, que ces trois groupes étaient associées, s’aidaient les uns les autres et étaient connectés « au » terrorisme international et à Al Qaïda au niveau mondial (« Three Terrorist Groups in Africa Pose Threat to U.S., American Commander Says » par Thom Shanker et Eric Schmitt, New York Times, 15 septembre 2011). Ils sont donc une menace pour les États-Unis (et le monde, bien sûr) et nécessitent qu’on prenne des mesures à leur encontre.
Avant d’aller plus loin, une petite explication sur le mode de fonctionnement du système militaire US au niveau mondial et les récentes évolutions qu’il a connu s’impose. Les Forces US sont réparties entre dix Commandements interarmés de combat (Unified Combattant Command) dont six couvrent des zones géographiques. Ces derniers sont dirigés par un général quatre étoiles ou un amiral qui supervise et commande toutes les troupes US se trouvant dans sa zone de responsabilité. Avant 2007, il n’existait que cinq grandes zones géographiques militaires mais, à l’été 2006, Donald Rumsfeld, alors secrétaire à la Défense, relança l’idée, proposée par différents rapports du Pentagone depuis le début des années 2000, de créer un nouveau Commandement interarmé de combat en charge de l’Afrique, recommandation qu’il renouvela au moment où il quitta ses fonctions en décembre 2006, laissant la place à Robert Gates. En janvier 2007, la Naval Postgraduate School de l’US Navy (l’université et le centre de recherche de la Marine US) publia un rapport préconisant une attention accrue des États-Unis en Afrique pour trois raisons : 1) la lutte contre « le » terrorisme, 2) la place croissante de l’Afrique dans les importations de pétrole états-uniennes, 3) le développement de l’influence chinoise en Afrique, jugée inquiétante. Le 6 février 2007, Robert Gates annonça que George W. Bush avait autorisé la création de l’US Africacom. Ce nouveau Commandement interarmé dirigeait désormais toutes les troupes US en Afrique, exception faite de celles d’Egypte qui restait sous le contrôle de l’US Central Command (le Commandement interarmé en charge des pays du Proche et Moyen-Orient, des ex-républiques soviétiques d’Asie centrale, du Pakistan et de l’Afghanistan). L’essentiel des troupes sous la direction de ce nouveau Commandement interarmé étaient les troupes engagées dans les opérations « Liberté immuable » au Sahel et au Sahara (Enduring Freedom Trans-Sahara en VO) et dans la Corne de l’Afrique (Enduring Freedom – Horn of Africa). Carter F. Ham a pris la direction de l’Africacom le 8 mars 2011, 11 jours seulement avant la mise en place de la zone d’exclusion aérienne en Libye.
Un peu plus de quatre ans avant que Donald Rumsfeld ne recommande la création d’un Commandement interarmé dédié à l’Afrique, le 25 janvier 2002, un symposium avait rassemblé des membres de l’administration Bush et des experts, souvent liés aux groupes politiques conservateurs et aux industries pétrolières US, à l’invitation de l’Institute for Advanced Strategic & Political Studies (IASPS), un think tank basé en Israël mais financé par des fondations « philanthropiques » conservatrices US et disposant de bureaux aux États-Unis. Paul Michael Whibey, membre important de l’IASPS, par ailleurs président d’un cabinet de conseil pour l’industrie pétrolière (GWEST) et participant à ce symposium avait décrit le but premier de ce think tank comme étant de « détourner la dépendance de l’Amérique en pétrole des pays du Golfe – hostiles à Israël – vers d’autres parties du monde. » (Africa Energy Intelligence, 5 Novembre 2002). La réunion conclut qu’il était nécessaire de créer un nouveau Commandement interarmé centré sur le Golfe de Guinée, que cette région devait être considérée comme une région vitale pour les intérêts états-uniens et que Washington devait tout faire pour développer l’extraction pétrolière en Afrique. Afin de soutenir ces idées, suite à ce symposium, un lobby, l’African Oil Policy Initiative Group (AOPIG), fut constitué et on en confia la coprésidence à Paul Michael Whibey (cité plus haut) et à Barry Shutz, un ancien analyste de la CIA et du département d’État. L’AOPIG appuya beaucoup de ses campagnes en direction des dirigeants US sur un rapport du National Intelligence Council, l’institut de réflexion de la CIA, qui prévoyait que 25% du pétrole consommé par les États-Unis en 2015 viendrait du seul Golfe de Guinée (contre 22% aujourd’hui pour les pays du Golfe arabo-persique). Actuellement, 15% des importations de pétrole aux États-Unis viennent du Golfe de Guinée dont 8% pour le seul Nigeria. Ce pétrole est considéré comme un brut d’excellente qualité et facile à raffiner.
On peut constater que les objectifs affichés de ce lobby ont été globalement exaucés. Le déploiement actuel (présence en Libye) ou annoncé (renforcement de la présence dans le Sahel, au Nigeria et en Somalie pour lutter contre le terrorisme) des forces US en Afrique correspond globalement aux pays africains ayant les plus importantes réserves pétrolières, comme le montre la carte ci-dessous.
La Somalie, où Carter Ham annonce une action de l’Africom, n’est pas, pour sa part, une zone pétrolière. En revanche, elle longe le Golfe d’Aden, zone maritime où transite 11% des transports maritimes de pétrole et une bonne partie des approvisionnements chinois. En août 2001, le gouvernement de George W. Bush signa un accord avec Djibouti pour installer une base permanente US sur son territoire (la seule base permanente états-unienne sur le continent). Au nom de la lutte contre le terrorisme puis contre la piraterie, une présence navale des États-Unis et de l’OTAN sillonne ce passage maritime. Suite à la publication d’informations sur la présence de combattants d’Al Qaïda au Yémen début 2010 et la très médiatique arrestation d’un jeune nigerian ayant étudié au Yémen et qui aurait tenté de faire exploser le vol Amsterdam-Détroit en cachant des explosifs dans ses sous-vêtements en janvier 2010, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire au Yémen. Une présence accrue en Somalie complèterait le contrôle militaire de cette région hautement stratégique.
Les arrières pensées stratégiques ou pétrolières dans le déploiement annoncé de l’Africom semblent d’autant plus importantes dans la logique de Washington que les ennemis désignés ne semblent que des menaces extrêmement localisées ou bien ont un historique qui suscite bien des interrogations.
D’après les informations publiées sur elle, la secte Boko Haram du Nigeria serait un groupe de musulmans sunnites intégristes et violents se réclamant des Talibans et officiant dans le Nord Est du pays. Les informations sur son compte sont plus que parcellaires et une recherche sur les sites de nombreux journaux ne les voit apparaître pour la première fois dans les articles qu’à l’été 2011, ceux-ci étant évoqués à l’occasion d’un attentat fin août qu’ils auraient commis à Abuja, la capitale nigériane, contre un bâtiment de l’ONU, faisant 18 morts. En dépit de cette action spectaculaire, il semble douteux de les considérer comme le problème prioritaire pour la stabilité du Nigéria, pays régulièrement traversé par des volontés séparatistes et où il existe de nombreux mouvements armés locaux. D’après Peter Lewis, directeur du programme d’étude africaines de la School of Advanced International Studies de l’Université Johns Hopkins, les Boro Haram ne seraient pas plus de 300 combattants (« Nigeria’s Boko Haram : Al-Qaeda’s New Friend in Africa ? » par Karen Leigh, Time, 31 août 2011), un total faible dans ce pays de 160 millions d’habitants qui comprend de nombreux groupes armés plus importants. Le Nigeria dispose de très importantes réserves pétrolières mais sa production s’effondre en raison des sabotages organisés par le MEND (le Mouvement pour l’émancipation du Delta du Niger), un mouvement armé – non confessionnel -concentré dans le Sud Est du Nigeria qui réclame que les populations locales bénéficient davantage des revenus du pétrole et que les compagnies pétrolières et le gouvernement fédéral nigérian réparent les terribles dommages environnementaux causés par l’exploitation pétrolière dans la région et dont souffrent les populations locales. Le MEND est accusé de nombreuses attaques contre des pipelines pétroliers et aussi d’attentats à la bombe à Abuja en octobre 2010, lors des célébrations pour les 50 ans de l’indépendance du pays (attentat dont furent également soupçonnés cependant des proches de l’ancien dictateur nigérian, le général et milliardaire Ibrahim Babangida). En avril 2010, le président nigérian Goodluck Jonathan a signé un accord de partenariat stratégique avec les États-Unis, accord comprenant un volet militaire. Il sera intéressant d’observer si la présence militaire US justifiée par le partenariat stratégique et la volonté de lutter contre « le » terrorisme se concentre sur le Nord, où sont sensés se trouver les Boro-Haram, ou sur les régions pétrolifères du Sud.
Les Shebab somaliens sont une des factions en lutte pour le contrôle du Sud de la Somalie, de Mogadiscio et de ses alentours. La Somalie est un pays qui concrètement n’existe plus, celui-ci étant divisé, pour faire court, en trois grandes zones. Au Nord Ouest, le Somaliland, est un État indépendant de facto depuis 1991, mais non reconnu par la communauté internationale, qui jouit d’une certaine stabilité, de relativement bons résultats économiques et qui, chose rare dans la région, a mis en place un système politique démocratique avec des élections multipartites qui ont déjà vu des alternances politiques pacifiques à la tête de « l’État ».
Au Nord-Est, on trouve le Puntland, autonome depuis 1998 qui ne réclame pas l’indépendance mais de devenir une région autonome au sein d’une future confédération somalienne. Traditionnellement une des régions les plus pauvres de la Somalie, c’est de là que viennent la plupart des pirates qui sévissent dans le Golfe d’Aden. La plupart sont d’anciens pécheurs ruinés par l’exploitation sauvage des zones de pêches par des bateaux étrangers, qui profitent de l’incapacité de la Somalie à faire respecter sa souveraineté dans ses eaux territoriales, ou par la perte de leurs bateaux lors du Tsunami de 2004. Certains se sont suffisamment enrichis grâce à cette activité pour devenir des armateurs pirates, sous-traitant l’activité de piraterie proprement dite.
Le Somaliland et le Puntland sont tous les deux soutenus par l’Ethiopie, ce qui ne les empêchent pas de s’être affrontés à plusieurs reprises pour des raisons frontalières.
Enfin, le Sud du pays, théoriquement dirigé depuis Mogadiscio est divisé entre clans et factions politiques qui s’affrontent violemment depuis le retrait en 2009 de l’armée éthiopienne qui avaient chassé du pouvoir les tribunaux islamiques.
La direction du pays est, très théoriquement, assurée par le Gouvernement Fédéral transitoire somalien, présidé par Sharif Sheikh Ahmed, qui ne contrôle réellement que quelques quartiers de Mogadiscio, le port maritime et l’aéroport, sous la protection d’environ 8 000 soldats burundais et ougandais de l’Union Africaine. Sharif Sheikh Ahmed n’a été élu à ce poste que par le Parlement fédéral transitionnel, en exil et rassemblé à Djibouti en 2009. Il est issu des anciens Tribunaux islamiques qui gouvernaient le pays mais il est présenté comme un « islamiste modéré » dans la plupart des articles que la presse occidental lui consacre. L’Union européenne assure la formation d’un embryon d’armée nationale somalienne en Ouganda et à Djibouti et sécurise le ravitaillement de cette armée par voie de mer au travers de l’opération Atalante. La situation dans cette zone est encore compliquée par l’Ethiopie et l’Erythrée qui s’y affrontent par faction interposées, envenimant régulièrement la situation.
Les Shebab sont une des factions islamistes contrôlant une partie du Sud du pays, probablement la plus médiatisée depuis que, en 2009, ses membres ont déclaré leur « allégeance » à Al Qaïda, vassalité affichée dont ils espéraient sans doute obtenir des soutiens extérieurs mais dont les effets semblent surtout avoir été symboliques. Les Shebab sont opposés aussi bien aux chefs de guerre locaux, qu’à d’autres factions issus des anciens tribunaux islamiques ou au Gouvernement Fédéral transitoire et à ses alliés étrangers. En juillet 2010, les Shebab auraient organisé un double attentat à Kampala pour faire payer à l’Ouganda son aide au Gouvernement Fédéral transitoire, ce qui démontrerait une capacité à frapper dans une partie de l’Est africain. Mais, depuis l’été 2011, les Shebab ont été contraints de quitter les quartiers de Mogadiscio qu’ils contrôlaient et, avec la famine liée à la sécheresse, le groupe serait soumis à de graves dissensions internes, les différents chefs se disputant sur l’accès des organisations humanitaires aux zones qu’ils contrôlent et sur la répartition des « frais de passage ».
Reste Al Qaïda au Maghreb Islamique, AQMI, organisation très médiatisée et dont la présence a été relevée dans de nombreux pays africains mais dont l’histoire n’est pas exempte de faits troublants. En effet, bien que cette organisation soit désormais présentée comme active dans une zone dépassant largement les frontières algériennes, elle est le dernier avatar en date des mouvements armés islamistes algériens nés au début des années 90 puisque AQMI n’est que le nouveau nom du Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) scission en 1998 des Groupes Islamiques Armés (GIA). Or, dans leur livre « Françalgérie, crimes et mensonges d’État » (La Découverte, version réactualisée en 2005), les journalistes Jean-Baptiste Rivoire et Lounis Aggoun exposent, de façon convaincante, comment les généraux algériens ont instrumentalisé la menace terroriste islamiste pour se maintenir au pouvoir au nom de la sécurisation du pays. Pour cela, d’après Rivoire et Aggoun, la sécurité militaire, la DRS, avait mis en place de faux maquis islamistes (sur le même modèle que la « Force K » mise en place par l’armée française lors de la Guerre d’Algérie), avait placé des hommes clés dans certains maquis sincères ou avait laissé agir impunément certains groupes particulièrement violents. Les deux journalistes estiment ainsi que Djamel Zitouni, « Emir » des GIA entre 1994 et 1996, et, à ce titre, présenté comme l’ordonnateur du détournement du vol d’Air France Alger-Paris en 1994, de la vague d’attentats en France en 1995-96, de l’assassinat des moines de Tibhirine et de nombreux massacres aussi sanglants que contre-productifs pour la cause qu’il prétendait défendre, était soit un agent direct de la DRS soit étroitement contrôlé par ces services. Cette version a été corroborée par les témoignages de déserteurs de l’armée algérienne, d’anciens diplomates algériens ou d’anciens membres des services secrets français.
Le GSPC est issu d’une scission des GIA intervenue en 1998. Un de ses chefs aurait été Abderazak El Para, surnommé par la presse le « Ben Laden du Sahel » (ou « du Sahara »). Ancien militaire algérien, il aurait été un des gardes du corps du général Nezzar (un des responsables de la sanglante répression des manifestations de 1988 en Algérie et un des parrains du régime algérien) entre 1991 et 1993 avant de rejoindre les GIA auprès du fameux Djamel Zitouni puis, après l’assassinat de ce dernier, d’Hassan Hattab, le fondateur du GSPC. A partir des années 2000, son nom sera cité dans plusieurs opérations du GSPC et notamment des enlèvements de touristes ce qui en fait officiellement l’ennemi public numéro un en Algérie. Mais, au début de l’année 2004, il est capturé par un mouvement rebelle tchadien, le Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad (MDJT), alors qu’il était replié dans le Tibelsi tchadien. Ce mouvement, opposé au régime du président Idriss Deby et souhaitant obtenir une légitimité internationale, propose de le livrer au gouvernement algérien, états-unien, puisqu’il était présenté comme lié à Ben Laden, ou allemand, El Para étant responsable de l’enlèvement de touristes allemands. D’après les responsables de ce mouvement, curieusement, aucun de ces trois gouvernements ne donnera suite à la proposition et l’Algérie enverra même un commando tenter de libérer El Para avant d’affirmer faussement que ce dernier a été vendu par le MDJT au GSPC, opération de propagande que le MDJT éventera en organisant une rencontre entre leur prisonnier et des journalistes de Paris Match. Finalement, le MDJT livrera El Para à la Libye du Colonel Kadhafi qui, huit mois plus tard, à la fin de l’année 2004, le livrera à l’Algérie. Bien qu’il soit officiellement entre les mains du pouvoir algérien, il sera jugé par contumace en juin 2005, la justice algérienne prétextant que la procédure par contumace avait été engagée avant son arrestation. Depuis, personne ne l’a revu (« Enquête sur l’étrange « Ben Laden du Sahara » », par Jean-Baptiste Rivoire et Salimah Mellah, Le Monde diplomatique, février 2005). La presse algérienne continue de présenter El Para comme un islamiste pur et dur et comme l’un des inspirateurs d’AQMI.
Les successeurs d’Abderazak El Para, eux-aussi souvent issus des GIA, suscitent également de nombreuses questions, tout comme les liens de ces derniers avec Al Qaïda (voir « L’« ennemi algérien » de la France : le GSPC ou les services secrets des généraux ? » par Omar Benderra, François Gèze, Salima Mellah, Algeria-Watch, 23 juillet 2005). En 2007, le GSPC devient AQMI, officialisant ses liens avec Al Qaïda en changeant de nom.
Si aujourd’hui, Lounis Aggoun assure qu’AQMI n’est qu’une émanation de la DRS, Jean-Baptiste Rivoire ne va pas aussi loin, convaincu que la DRS instrumentalise ce mouvement sans garantir quel est son degré de contrôle sur cette organisation ou les différents groupes qui s’en réclament.
Les attentats du 11 septembre 2001 avaient été une divine surprise pour les généraux algériens qui peinaient alors à se maintenir au pouvoir et éprouvaient des difficultés à trouver des soutiens internationaux alors que de plus en plus de questions sur leur rôle exact dans les massacres commis en Algérie étaient soulevées. L’administration Bush profita de ces attentats pour amorcer un spectaculaire rapprochement avec un régime très critiqué durant les années Clinton, justifiant ce rapprochement par la lutte contre un ennemi commun, Washington accusant également Abderazak El Para d’être un lieutenant de Ben Laden chargé d’implanter Al Qaïda dans la région du Sahel. En visite officielle à Alger en décembre 2002, William Burns, alors secrétaire d’État adjoint US pour le Proche-Orient déclara « Washington a beaucoup apprendre de l’Algérie en matière de lutte contre le terrorisme ». Ainsi adoubés, les généraux algériens, et notamment le général Mohammed « Toufik » Médiène, le tout puissant patron de la DRS depuis 1990, purent faire taire les critiques internationales concernant leur pouvoir. Les États-Unis vendirent à l’Algérie du matériel « antiterroriste » et s’implantèrent dans la très pétrolifère région du Sahel, via l’opération Enduring Freedom – Trans Sahara, opération où les troupes algériennes forment le second contingent en homme derrière les États-Unis.
Le partenariat entre les États-Unis et l’Algérie est désormais très étroit. Le général Carter Ham a ainsi participé à la Conférence internationale sur le partenariat, la sécurité et le développement entre les pays du Sahel à Alger, les 6 et 7 septembre 2011 et il a été reçu par le président Bouteflika. Il prouvait ainsi que Washington ne tenait absolument pas rigueur à Alger pour son absence de soutien à l’opération de l’OTAN contre Kadhafi. De son côté, l’Algérie préside actuellement la délégation des États du Sahel lors de la séance constitutive du nouveau « Forum mondial de lutte contre le terrorisme » qui a débuté ce 22 septembre à New York.
 |
| Carter Ham, le 9 septembre 2011 lors d’une conférence de presse à l’ambassade US à Alger |
Dans son rapport de janvier 2007 sur l’opportunité de créer un Commandement interarmé de combat en Afrique, l’US Navy avait fixé trois objectifs : la lutte contre le terrorisme, la sécurisation de l’approvisionnement en pétrole venu d’Afrique et la lutte contre le développement de l’influence chinoise sur le continent. Au vu des exagérations autour de la menace posée par certains groupes armés ou du jeu ambigu joué par l’Africom concernant certaines organisations aux allégeances douteuses, il semble bien que le premier objectif ne soit que le prétexte permettant de justifier les deux autres buts de l’Africom aux yeux de l’opinion publique mondiale.
Source : Blog CPPN


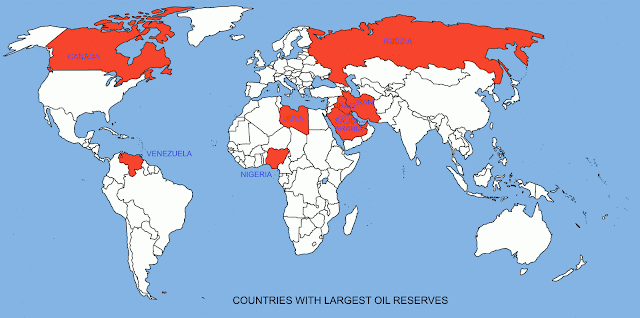





































0 <<< VOS COMMENTAIRES:
VOS COMMENTAIRES